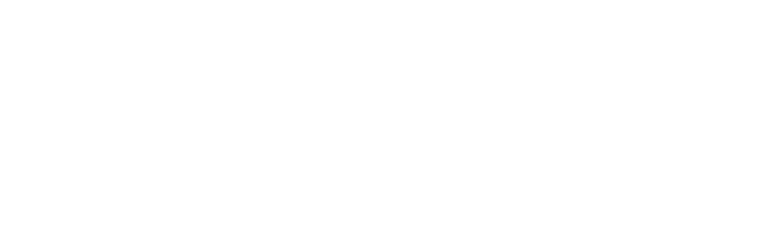- 050661531
Affichage de 239 résultats
Notice d'autoritéŚrī Saddhātissa International Buddhist Centre
- Collectivité
- 029720877
- Personne
- 1890-1968
Membre de l'École française d'Extrême-Orient de 1922 à 1925 et de 1936 à 1941,correspondant de 1926 à 1936. Fondatrice de la Bibliothèque royale du Cambodge et d'instituts boudhiques au Cambodge et au Laos. Diplômée de Langues'O en siamois. Née à Calcutta
- 034556451
- Personne
Diplômé de l'université de Lancaster, GB. Chercheur, Pali text society, Oxford, GB (en 1994)
- 18736382X
- Personne
- 19..-...
- 078831660
- Collectivité
- 1904-...
Association pour but de promouvoir la culture thaï, les arts, la nature et la préservation des plantes à travers des expositions, des recherches et des publications. Créée par des Thaïs et des résidents étrangers en Thaïlande, la Siam Society est aujourd'hui une organisation non-gouvernementale sous le patronage royal
Chung-Hwa Institute of Buddhist Studies (CHIBS)
- Collectivité
Varenne, Jean (1926-1997 ; sanskritiste)
- 027177491
- Personne
- 1926-1997
Professeur d'enseignement général de l'enseignement technique, Jean Varenne soutient en 1959 une thèse de sanskrit à l'EPHE, IVe section, publiée en 1960. Il est détaché au ministère des Affaires étrangères en tant que lecteur de français à l'université de Poona d'avril 1959 à avril 1960. Il est par la suite détaché à l'EFEO, de mai 1960 à octobre 1962, pour occuper un poste contractuel de chargé de recherches indianistes. Il séjourne alors au Cambodge, à Poona et à Pondichéry.
Schipper, Kristofer Marinus (1934-2021)
- 027126331
- Personne
- 1934-2021
Diplômé de l'EPHE, Ve section (1962), licencié de chinois à la faculté des lettres de Paris (1961), diplômé de l'École des langues orientales (chinois, 1958 ; japonais, 1960) et ancien élève de l'École du Louvre (1957-1958), Kristofer Schipper est membre de l'EFEO de 1962 à 1972 et affecté à Taiwan de 1962 à 1970, pour y établir la première antenne sinologique. Il quitte l'École pour devenir directeur d'études des religions de la Chine à l'EPHE, Ve section (1973). Par la suite, il est de nouveau envoyé pour une courte mission par l'EFEO à Taiwan, en 1974, afin de recueillir des documents et veiller sur les travaux d'impression en cours. Il est docteur d'Etat ès lettres en 1983.
Formé par Rolf A. Stein et Max Kaltenmark, il est spécialiste de l'histoire du taoïsme. Dès son arrivée à Taiwan, il découvre ce que J. J M. De Groot avait subrepticement évoqué un siècle plus tôt : la religion taoïste vivante. Pour appronfondir cet aspect, honni à l'époque par les intellectuels chinois et ignoré de leurs collègues occidentaux, il suit lui-même une initiation de maître taoïste, qui aboutira en 1968 à son ordination. Grâce à cette « observation participante » avant la lettre, il mène des enquêtes sur l'une des dernières églises vivantes du taoïsme et réunit une masse considérable de documents originaux et de renseignements de première main. Désireux de guider les futurs chercheurs dans les labyrinthes du taoïsme, il dirige parallèlement l'établissement d'index d'ouvres taoïstes classiques. Résultat de son expérience de terrain et de son savoir, son ouvre majeure, Le Corps taoïste, décrit et analyse la manière dont le corps social (les participants aux rituels communautaires), le corps physique (celui de l'adepte pratiquant l'alchimie intérieure) et le corps cosmique (le corps comme macrocosme) sont imbriqués. Ses plus récentes recherches l'ont amené à s'intéresser de très près aux structures liturgiques de la ville de Pékin, dont les résultats paraissent, numéro après numéro, dans la revue qu'il a fondée en 1997, Sanjiao wenxian. Matériaux pour l'étude de la religion chinoise (Paris/Leyde, École pratique des hautes études/Center for Non-Western Studies).
Fondateur et directeur du Centre de documentation et d'étude du taoïsme de l'EPHE, il a été également directeur de l'Institut des hautes études chinoises du Collège de France (1987-1992), directeur du projet Tao-tsang, qui doit prochainement aboutir dans la publication, en collaboration avec Franciscus Verellen, de The Taoist Canon: A historical compendium to the Daozang. Il a été par ailleurs responsable de deux groupes de recherche du CNRS : « Bibliographie taoïste » (1979-1985) et « Pékin ville sainte » (1996-1999).
- 027131211
- Personne
- 1938-1991
Anna Seidel apporte une vision originale et féconde sur le taoïsme. Sa thèse, La divinisation de Lao-tseu dans le taoïsme des Han (1969), bouleverse les données sur cette religion, alors trop simplement divisée en courants philosophiques et mouvements religieux populaires. Membre de l'EFEO à partir de 1969, elle partage son temps entre les études taoïstes, dont elle affine l'approche, et les études bouddhiques. Elle participe activement à la rédaction de l'encyclopédie bouddhique Hôbôgirin. En 1985, elle crée et dirige les Cahiers d'Extrême-Asie, revue publiée par le centre de l'EFEO à Kyôto.
Depuis sa première étude, La divinisation de Lao Tseu, jusqu'à son dernier article, « Chronicle of Taoist Studies in the West 1950-1990 » (Cahiers d'Extrême-Asie 5, 1989-1990), elle ne cesse d'insister sur l'implication du taoïsme dans l'État chinois. Elle mène une large enquête sur les trésors impériaux chinois et les objets sacrés taoïstes (« Imperial treasures and taoist sacraments », Tantric and taoist studies, 1983) et étend son étude au Japon antique et au monde bouddhique (« Kokuhô, note à propos du terme trésor national en Chine et au Japon », BEFEO, 1981).
Son intérêt est également marqué pour la mythologie et l'eschatologie du taoïsme, pour l'étude des croyances concernant l'au-delà dans le taoïsme, le bouddhisme et les religions populaires de Chine et du Japon (Le sûtra merveilleux du Ling Pao suprême, 1984). Elle suit l'évolution de ces pratiques depuis les Han jusqu'à l'époque contemporaine.