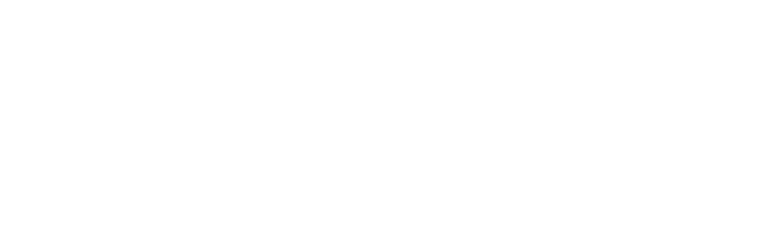Licencié ès lettres, diplômé de chinois de l'École des langues orientales, Paul Pelliot est, dès 1899, nommé pensionnaire de la Mission archéologique en Indochine, puis professeur de chinois deux ans plus tard. Il se donne pour tâche de rassembler les documents fondamentaux de l'histoire indochinoise et particulièrement les textes chinois qui constituent les plus anciens textes historiques sur les pays de l'Indochine.
Il est envoyé en mission à Pékin, en 1900, en vue de constituer une bibliothèque chinoise. Son séjour correspond en Chine à la révolte des Boxeurs. Pour sa conduite devant le siège des Légations, P. Pelliot se voit nommer chevalier de la Légion d'honneur. Il prolonge son séjour en Chine pour ses recherches bibliographiques et regagne Saigon en 1901 avec une ample moisson de livres, de peintures et d'objets d'art, qui constituent le premier fonds de la bibliothèque et du musée de l'EFEO.
Sous son influence se développe, dans la branche sinologique de l'École, des recherches de philologie axées sur la géographie historique des pays de l'Indochine à travers les sources chinoises. Parmi ses publications, on retient notamment ses articles « Mémoires sur les coutumes du Cambodge de Tcheou Ta-Kouan », qu'il traduit et annote dans le BEFEO (1902), et « Le Fou-Nan » (BEFEO, 1903), dont il situe précisément le royaume. L'année suivante, P. Pelliot publie, toujours dans le BEFEO, « Deux itinéraires chinois de Chine en Inde à la fin du VIIIe siècle », commentaire nourri d'une nomenclature géographique qui constitue alors l'une des bases de l'histoire de l'Asie du Sud-Est. Il inventorie à Hué les livres chinois et vietnamiens des collections impériales et en fait copier un bon nombre, afin de constituer le premier fonds d'ouvrages vietnamiens de l'École. Ce travail se solde par une publication, en collaboration avec le R. P. Cadière, sur les sources annamites de l'histoire d'Annam » (BEFEO, 1904).
Une nouvelle mission, de 1906 à 1908, le mène en Asie Centrale et lui permet de fouiller plusieurs sites et de recueillir plus de 6 000 manuscrits et peintures dans les grottes de Dunhuang. On peut lire le récit de cette découverte dans le BEFEO, 1908 : « Une bibliothèque médiévale retrouvée au Kan-Sou ». En trois semaines, il entreprend et mène à bien le dépouillement de dizaines de milliers de manuscrits entassés dans une des grottes.
En 1909, de retour à Paris, il occupe le nouveau poste de sous-directeur de l'EFEO, jusqu'à sa démission, qu'il donne afin d'occuper la chaire de Langues, histoire et archéologie de l'Asie Centrale, au Collège de France, créée à son intention : P. Pelliot est alors âgé de 33 ans. Il délaisse pour un temps les travaux de sinologie pure, afin de se livrer plus spécialement à l'histoire des langues turques et mongoles et se consacrer aux récits de voyageurs chinois et européens qui ont traversé l'Asie ou se sont rendus en Chine. Pendant la première guerre, il est mobilisé, part aux Dardanelles, puis à Pékin comme attaché militaire.
Ses occupations ne l'empêchent pas de multiplier, dans le BEFEO, le T'oung Pao et le Journal asiatique, les articles sur la linguistique et la chronologie chinoise. En 1920, il assure avec H. Cordier la direction du T'oung Pao, en remplacement d'Édouard Chavannes, mort en 1918.
Il est élu membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres en 1921, il est également vice-président, et plus tard, après S. Lévi, président de la Société asiatique, président de l'Institut des hautes études chinoises. En 1932, il est chargé par le ministère des Affaires étrangères d'une mission en Extrême-Orient et profite de son voyage pour s'arrêter à Bangkok, Phnom Penh, Siem Reap, Saigon et Hanoi.
P. Pelliot a publié, de son vivant, de nombreux et souvent gros articles, mais aucun ouvrage. À sa mort, il laisse de nombreux manuscrits qui ont été publiés depuis ou qui restent encore inédits.