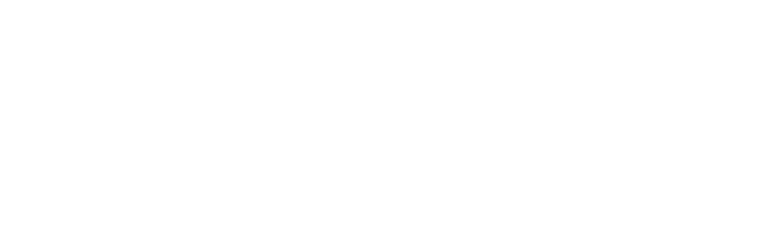- 081823770
- Person
Showing 155 results
Authority record- 03465495X
- Person
- 1896-1979
Ancien élève de l'École des arts décoratifs de Nice et de l'École supérieure des beaux-arts de Paris, Jean-Yves Claeys devient architecte. En 1923, il est lauréat du Salon des artistes français.
De février 1923 à mai 1927, il est architecte dans les services des Travaux publics de l'Indochine, mais, passionné par l'archéologie, il demande à entrer à l'EFEO. Il est nommé membre temporaire en juin 1927, puis membre permanent en 1930. Il dirige les premières fouilles du site cam de Tra Kiêu (Quang Nam), de 1927 à 1928, exhumant les fondations de temples et un nombre très important de sculptures. En 1934, il dirige un autre chantier à Thap Mâm (Binh Dinh). Il devient Conservateur des monuments de l'Annam-Campa, section du service archéologique, qu'il crée et organise, séjournant de longs mois sur le terrain. Parallèlement, il travaille à une enquête ethnologique et technologique commandée conjointement par le musée indochinois du Trocadéro, le musée d'Histoire naturelle de Paris et l'EFEO. Il prend en charge le poste de secrétaire-bibliothécaire de l'École en 1934. En 1937, il est nommé chef du service archéologique de l'EFEO, poste qu'il avait déjà occupé par intérim en 1933. Il assure, après le décès de Charles Batteur, le service de la Conservation des monuments du Tonkin.
En 1943, des problèmes pulmonaires l'obligent à arrêter ses activités professionnelles pendant quelques mois. Il publie une étude sur l'archéologie du Siam et une introduction à l'étude de l'Annam et du Campa.
En septembre 1946, atteint de tuberculose, il est rapatrié en France. Son état ne lui permettant plus de revenir en Indochine, il sera en congé de longue durée jusqu'en 1953, date de sa retraite, il est alors nommé directeur d'études de classe exceptionnelle de l'EFEO.
Filliozat, Jacqueline (1942-....)
- 06106632X
- Person
- 1942-...
Spécialiste en codicologie pālie. Membre de l'Ecole française d'Extrême-Orient depuis 1969. Responsable du programme de l'EFEO "Manuscrits de Birmanie et de ses périphéries".
Fille de l'indianiste Jean Filliozat, Jacqueline Filliozat est confrontée très tôt à la culture indienne. Elle suit les classes du Collège français de Pondichéry tout en fréquentant l'Ashram de Sri Aurobindo où elle rencontre S. Karpelès qui va marquer sa vie. Elle s'initie aux diverses langues de l'Inde (tamoul, bengali, hindi, sanskrit) et à la danse de style bharatanatyam qu'elle pratique quotidiennement une dizaine d'années dans la tradition d'un maître de Tanjore. En même temps que des études d'ourdou et de hindi à l'École des langues orientales de Paris en tant qu'auditeur libre, elle suit les cours de Ch. Vaudeville à la IVe section de l'École pratique des hautes études. Elle établit le fichier du fonds des imprimés indiens du Collège de France et s'exerce à la compilation en rédigeant quelques articles sur les littératures indiennes dans l'Encyclopaedia Universalis. Mais c'est en philologie bouddhique du Theravāda pāli qu'elle s'oriente finalement à 24 ans auprès du bouddhologue A. Bareau après avoir reçu les premiers rudiments au cours d'initiation au pāli par G. Martini.
Encouragée par un maître singhalais éminent, le Vénérable Walpola Rahula qui suit ses recherches pas à pas, elle prépare un diplôme en philologie pālie à l'EPHE (IVe section) avec A. Bareau et entre à l'EFEO en 1969 comme chargée de recherche.
- 034586792
- Corporate body
- 1882-...
- 069682178
- Person
- 1876-1970
Bachelier ès lettres et philosophie et bachelier ès lettres et mathématiques en 1895, Henri Marchal est admis à l'École des Beaux-Arts, section architecture, dans l'atelier dirigé par Gaston Redon. Parallèlement, il donne des conférences dans les universités populaires et un cours du soir de dessin industriel à l'Association polytechnique.
Nommé Inspecteur des bâtiments civils du Cambodge en 1905, il effectue une mission en Thaïlande afin de préparer le projet d'une nouvelle légation de France. En 1910, il passe le Brevet de langue cambodgienne ; il est nommé conservateur-adjoint du musée de l'École à Phnom Penh, en tant que responsable de la nouvelle section des antiquités khmères. En 1912, il est affecté à Saigon, comme inspecteur des bâtiments civils de la Cochinchine.
En 1916, à la suite de la disparition de Jean Commaille, il est détaché auprès de l'EFEO pour assurer la direction de la Conservation d'Angkor. Il reprend tout d'abord l'œuvre de débroussaillement d'Angkor Vat et des principaux monuments construits à la périphérie de la Place royale (Bayon, Baphuon, Palais royal, Preah Pithu, etc). Cette mise en valeur de la zone centrale d'Angkor Thom est complétée par le repérage des très nombreux vestiges situés à l'intérieur ou à proximité immédiate de l'enceinte d'Angkor Thom (BEFEO 18). En 1919, Henri Marchal est nommé membre permanent de l'EFEO et Conservateur d'Angkor. Il poursuit le dégagement des douves d'Angkor Vat, en même temps qu'il entreprend des consolidations ponctuelles au Bakheng (1922-1929), au Baphuon, au Bayon, à la Porte de la Victoire, ainsi que dans des monuments légèrement excentrés comme le Preah Khan ou Bantey Kdei. Il prend cependant conscience des limites des méthodes de consolidation utilisées jusqu'alors et, en 1930, part à Java pour étudier les principes de l'anastylose auprès du service archéologique des Indes néerlandaises (BEFEO 30).
À son retour, il décide de les mettre en œuvre sur le temple de Bantey Srei, récemment découvert (1931-1933). Cette restauration est unanimement saluée. En 1933, Henri Marchal prend officiellement sa retraite et quitte la Conservation d'Angkor pour remplacer Henri Parmentier à la tête du service archéologique de l'EFEO. En 1938, sur le chemin du retour vers la France, il effectue un séjour à Ceylan et en Inde, dont il donnera un récit imagé dans le Souvenir d'un ancien conservateur d'Angkor.
Arrivé en France au début de la guerre, il y restera jusqu'en 1946, année où il effectue une mission à Pondichéry pour prendre la direction du chantier de Virampatnam. Un an plus tard, il est rappelé pour assurer le remplacement de Maurice Glaize comme Conservateur d'Angkor et y reste six ans. Il restaure les édifices situés le long de la chaussée ouest d'Angkor Vat (1948) et travaille aussi à la Terrasse des Éléphants (1948), au Baphuon (1948), à Bantey Kdei (1950), au Prah Khan (1950) et à Thommanon (1950).
Après un bref séjour en France, il repart à Hanoi pour assurer temporairement la conservation du musée Louis Finot. En 1954, il est nommé conseiller technique des monuments historiques et chef du bureau de l'architecture au ministère des Travaux publics du Royaume du Laos, poste qu'il occupe jusqu'en 1957. C'est à cette date qu'il prend définitivement sa retraite et décide de rester au Cambodge. Il s'installe alors à Siem Reap, où il décède à l'âge de 94 ans.
La vie d'Henri Marchal se confond pendant près de quarante ans avec les travaux de restauration menés sur le site d'Angkor. Profondément attaché au Cambodge et à la conservation de son patrimoine, il a professionnalisé l'action de l'École, en appliquant aux monuments khmers les procédés développés en Grèce et à Java. Appelé à travailler sur de très nombreux monuments, il en a donné des descriptions précises, tant dans les Journaux et Rapports de fouilles que dans de très nombreuses monographies, qui sont un support indispensable à l'approche architecturale de bien des monuments.