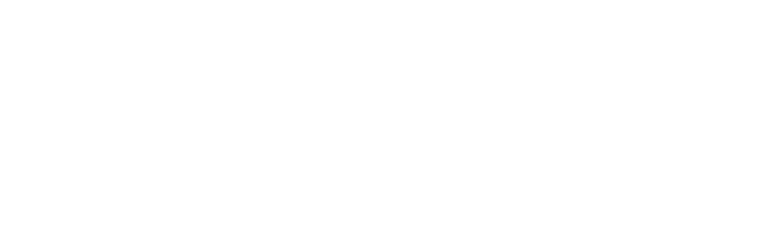- 03465495X
- Personne
- 1896-1979
Ancien élève de l'École des arts décoratifs de Nice et de l'École supérieure des beaux-arts de Paris, Jean-Yves Claeys devient architecte. En 1923, il est lauréat du Salon des artistes français.
De février 1923 à mai 1927, il est architecte dans les services des Travaux publics de l'Indochine, mais, passionné par l'archéologie, il demande à entrer à l'EFEO. Il est nommé membre temporaire en juin 1927, puis membre permanent en 1930. Il dirige les premières fouilles du site cam de Tra Kiêu (Quang Nam), de 1927 à 1928, exhumant les fondations de temples et un nombre très important de sculptures. En 1934, il dirige un autre chantier à Thap Mâm (Binh Dinh). Il devient Conservateur des monuments de l'Annam-Campa, section du service archéologique, qu'il crée et organise, séjournant de longs mois sur le terrain. Parallèlement, il travaille à une enquête ethnologique et technologique commandée conjointement par le musée indochinois du Trocadéro, le musée d'Histoire naturelle de Paris et l'EFEO. Il prend en charge le poste de secrétaire-bibliothécaire de l'École en 1934. En 1937, il est nommé chef du service archéologique de l'EFEO, poste qu'il avait déjà occupé par intérim en 1933. Il assure, après le décès de Charles Batteur, le service de la Conservation des monuments du Tonkin.
En 1943, des problèmes pulmonaires l'obligent à arrêter ses activités professionnelles pendant quelques mois. Il publie une étude sur l'archéologie du Siam et une introduction à l'étude de l'Annam et du Campa.
En septembre 1946, atteint de tuberculose, il est rapatrié en France. Son état ne lui permettant plus de revenir en Indochine, il sera en congé de longue durée jusqu'en 1953, date de sa retraite, il est alors nommé directeur d'études de classe exceptionnelle de l'EFEO.