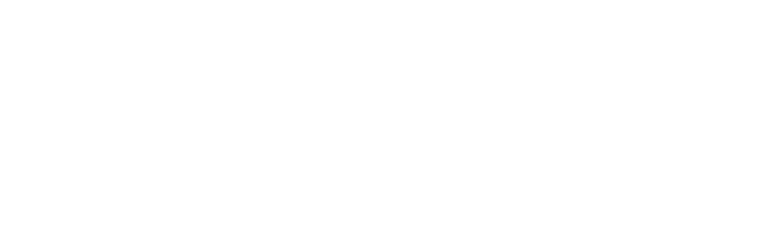- 027063429
- Person
- 1934-2014
Christian Pelras, né le 17 août 1934 et mort le 19 juillet 2014, est un ethnologue français spécialiste de l’Indonésie. Il étudie dans un premier temps la sociologie et l’ethnologie à Paris, puis apprend l’indonésien d’abord à l’Ecole des Langues Orientales puis en Indonésie grâce à une bourse du gouvernement indonésien. Il débute en tant que chercheur en 1962 au Musée de l’Homme et écrit une thèse sur la commune de Goullien située dans le Finistère. Suite à ces travaux il entre au CNRS en 1964 sous la direction d’André Leroi-Gourhan. Il est aussi affecté au Centre de documentation et de recherche sur l’Asie du Sud-Est et le monde insulindien (CEDRASEMI), dirigé par Georges Condominas. Il y restera jusqu’en 1984, année de la dissolution du CEDRASEMI. Par la suite il devient directeur de recherche puis en 1991, il est nommé codirecteur du LASEMA, le laboratoire d’Asie du Sud-Est et du monde austronésien. Il dirige l’établissement jusqu’en 1994 puis devient membre élu de son conseil. Christian Pelras prend sa retraite en 1999.