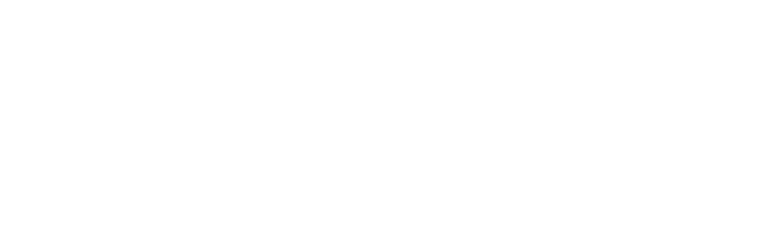Entré à l'École nationale des langues orientales en 1945, Léon Vandermeersch y obtient les brevets de chinois (1948) et de vietnamien (1950), tout en poursuivant simultanément à l'université des études de philosophie (licence d'enseignement et DES en 1946-1951) et de droit (doctorat obtenu en 1951). Il obtient ultérieurement le diplôme de l'École pratique des hautes études, VIe section, pour un mémoire sur le légisme chinois (1962), et le doctorat d'État ès lettres pour une thèse sur les institutions de la Chine archaïque (1975).
Sa carrière d'enseignant-chercheur a commencé à Saigon, par un premier poste de professeur au lycée Petrus Truong Vinh-Ky (1951-1954), auquel s'est ajoutée une charge d'enseignement de droit romain à la Faculté de droit (1952-1954). Après un congé en métropole, un second poste le conduit au lycée Albert Sarraut de Hanoi (1955-1956), encore français, mais déjà sous le régime de la République démocratique du Vietnam. De ce second poste, il est rapidement retiré par la Délégation générale de France à Hanoi, pour être affecté, vu les nécessités du service, dès avril 1956, à la conservation du musée Louis Finot. Ce musée dépend de l'EFEO, où L. Vandermeersch entre alors comme chercheur. Suivent dix années d'activité à l'École, d'abord en études vietnamiennes à Hanoi, sous la direction de M. Durand, à quoi s'ajoute l'administration par interim du centre de Hanoi, après le retour à Paris de M. Durand en 1957 - charge qui a comporté notamment, par application des accords de Genève, le transfert aux autorités vietnamiennes de la bibliothèque et du musée de l'École -, suivie de la réinstallation du centre de l'École dans un nouveau local (ultérieurement abandonné lors de la rupture de l'École avec les autorités de Hanoi en 1959). Rentré à Paris en 1958, L. Vandermeersch passe aux études chinoises, sous la direction de P. Demiéville. Il est alors affecté successivement à Kyôto, où il travaille à la section orientale du Jinbun kagaku kenkyusho tout en poursuivant sa formation sinologique à l'université de Kyôto auprès de Shigezawa Toshio (en philosophie chinoise ancienne), d'Ogawa Tamaki (en littérature classique) et de Yoshikawa Kojiro (en explication du Shiji) ; à Hong Kong, où il est reçu comme research fellow au Département de chinois de l'École de langues de l'université, et travaille la paléographie et la linguistique du chinois ancien auprès de Jao Tsung-I (à la disposition duquel il sera ultérieurement placé comme assistant par l'EFEO, en Inde puis en France en 1963-1966) ; enfin, de nouveau à Kyôto, où cette fois il travaille l'histoire du droit chinois ancien au séminaire d'Uchida Tomoo, à l'université Doshisha.
Passé de l'EFEO à l'université en 1966, L. Vandermeersch occupe, en études chinoises, des postes successifs de maître de conférences, de professeur, puis de directeur d'études à la Faculté des lettres d'Aix-en-Provence, où il crée l'enseignement du chinois (1966-1973), à l'université Paris-VII, où il dirige l'UER d'Asie orientale (1973-1979) et enfin à l'École pratique des hautes études, Ve section, où il enseigne l'histoire du confucianisme (jusqu'à sa retraite en 1993). C'est en détachement de ce dernier poste qu'il a en outre assuré la direction de la Maison franco-japonaise de Tôkyô en 1981-1984 et la direction de l'EFEO en 1989-1993. L. Vandermeersch a, par ailleurs, entre autres fonctions, appartenu au Comité national du CNRS de 1976 à 1982 et de 1989 à 1993, il est cofondateur avec W. Th. De Bary du Comité américano-européen pour la promotion des études orientales, et a présidé de 1987 à 1993 la section européenne de ce comité.
Participant régulier aux colloques de sa spécialité se tenant en Asie, en Europe ou aux États-Unis, il en a lui-même organisé plusieurs à Tôkyô, à Paris et à Hanoi. Ses recherches ont porté principalement sur l'histoire des institutions et des idées politiques en Chine, sur l'idéographie chinoise, sur le confucianisme et sur le développement post-moderne du monde sinisé. Il s'est attaché, d'une part à développer ce que révélaient les apports les plus récents de l'archéologie et de l'épigraphie chinoises - notamment en initiant en France l'étude des inscriptions oraculaires Yin de la fin du IIe millénaire av. J.-C. - et d'autre part à valoriser l'application à la Chine et au monde sinisé du point de vue de l'histoire des mentalités. Ces recherches ont fait l'objet de six ouvrages et d'une centaine d'articles.
L. Vandermeersch est chevalier de l'Ordre de la Légion d'Honneur et de l'Ordre des Palmes académiques, décoré de l'Étoile d'or et d'argent de l'Ordre du Trésor sacré du Japon, correspondant de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, lauréat du prix Stanislas Julien et du prix d'Aumale de cette Académie.