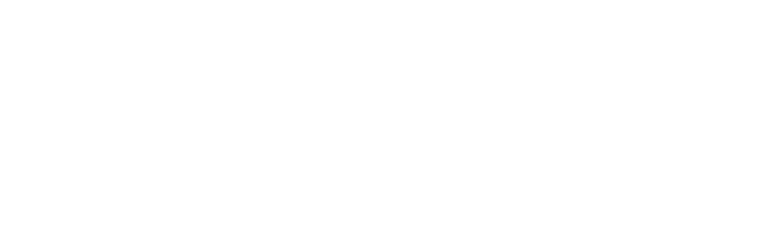Entré à l'université de Berlin, où il suit des cours de sinologie et d'ethnologie, Rolf Stein obtient son diplôme de langue chinoise en mars 1933 au Seminar für Orientalische Sprachen, puis se réfugie en France en avril 1933. À l'École nationale des langues orientales vivantes, il est diplômé de langue chinoise en 1934 et de langue japonaise en 1936. Il obtient son brevet d'élève titulaire de l'Institut des hautes études chinoises en 1934. Il fait des études de tibétain (Bacot et Lalou) et de mongol (Pelliot), suit des cours de sinologie (Granet, Pelliot, Maspero, Mestre, Escarra, Dubarbier), des cours de religions des peuples sans écriture (Mauss), de japonais (Haguenauer), et sur l'Asie du Sud-Est (Mestre).
Licencié ès lettres à la Sorbonne en 1937, il est naturalisé français le 30 août 1939. Il est engagé comme sinologue journalier à l'EFEO le 16 avril 1940, jusqu'à la date de sa mobilisation le 25 juin 1940. Il est alors envoyé au Vietnam, où il effectue son service actif dans l'Artillerie de montagne. Démobilisé en septembre 1941, R. Stein est traducteur de chinois et de japonais à l'État-major et au contrôle postal jusqu'en 1945.
Il est proposé comme membre de l'EFEO par l'Académie en janvier 1940, mais sa candidature n'est pas retenue, compte tenu des Lois de Vichy du 2 juin 1941 portant sur le statut des Juifs. R. Stein n'est nommé membre temporaire contractuel qu'à compter du Ier janvier 1945. Cependant, le 23 août 1946, un arrêté du ministère de la France d'outre-mer le nomme rétroactivement membre permanent de l'EFEO à compter du Ier juillet 1941.
Du 6 janvier 1946 au 29 février 1948, R. Stein est détaché à Pékin, au Centre franco-chinois d'études sinologiques, puis, à compter du Ier avril 1949 à l'École des langues orientales, en tant que professeur de chinois. Il quitte définitivement l'EFEO le 31 décembre 1950, pour être nommé directeur d'études à l'École pratique des hautes études, Ve section (Religions de la Chine et de la Haute Asie), le Ier janvier 1951. Il restera dans cette fonction jusqu'en 1975.
Il crée une collection de documents photographiques (Chine, Indochine, Japon, Tibet, Népal, Inde) au Centre documentaire d'histoire des religions, annexe du musée Guimet. En juin 1960, il obtient le doctorat d'État (L'épopée tibétaine). De 1963 à 1966, il enseigne la grammaire tibétaine à l'École des langues orientales et explique des textes chinois anciens (philosophie et religions) à l'Institut des hautes études chinoises. De 1966 à 1981 il est professeur au Collège de France, titulaire de la chaire d'« Étude du monde chinois : institutions et concepts ». En juin 1977, il est nommé docteur honoris causa à l'université de Bonn.
R. Stein savait allier les observations directes recueillies sur place à une érudition livresque très avertie, qui donnait la mesure de sa vocation sinologique. De 1960 à 1964, dans le cadre d'un projet international financé par la Fondation Rockefeller, il conduit un travail d'information avec quatre Tibétains (deux moines et un couple marié) ne parlant que tibétain et n'ayant jamais eu de contact avec le monde extérieur. Dans son travail sur le Lin-yi, un essai de géographie historique, c'est surtout par sa méthode qu'il réussit à renouveler l'exégèse de documents déjà connus. Formé à l'école de Marcel Granet, R. Stein se tient à l'affût des éléments légendaires et folkloriques que peuvent receler les textes historiques.